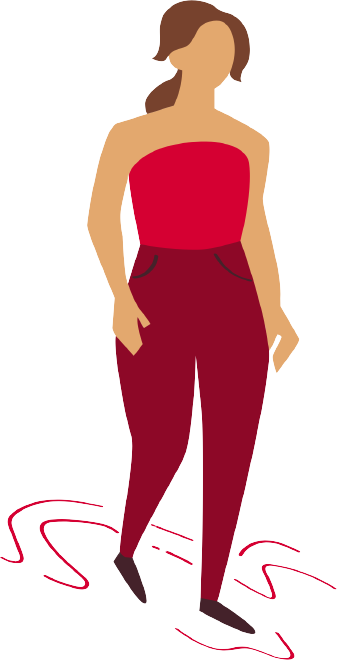De 1 195 en 2000 à 17 438 en 2018. C’est l’évolution du nombre de femmes licenciées dans des clubs de boxe, selon la Fédération Française de Boxe. Depuis vingt ans, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans les sports de combat pour (re)prendre confiance en elles et apprendre à se défendre. « J'ai commencé la boxe française parce que j’ai vécu du harcèlement au collège. Ça m'a toujours attirée de savoir me battre, mais aussi de pouvoir me défendre en cas de problème », raconte Claire Fourmy, étudiante de 21 ans. Depuis deux ans, elle a vu l’effectif de son club grimper. « Il y a beaucoup de filles qui viennent s'inscrire, presque autant, voire plus que les garçons », affirme-t-elle. Selon le ministère des Sports, la pratique féminine des sports de combat est passée de 22,9% à 30,7% entre 2012 et 2017.
Sandrine Moisan, présidente du club Trégor Boxing à Lannion, voit elle aussi ses effectifs augmenter d’année en année. « Depuis dix ans, il y a un peu plus de filles. Aujourd’hui, elles sont à peu près un tiers ». Elle explique cette augmentation par le succès du film Million Dollar Baby, sorti en 2004, qui met en scène une boxeuse. Mais aussi par les médailles d’or et d’argent d’Estelle Mossely et de Sarah Ourahmoune aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. « Obtenir une médaille en boxe, c’est dur. Là, il y en a eu deux chez les femmes françaises », explique Loïc Le Meitour, entraîneur à l'Athlétique Boxe Goelo Argoat à Paimpol. Il a lui aussi observé une augmentation des effectifs féminins de son club à la même période.
« En 2010, les femmes représentaient 25% des effectifs. Après les Jeux Olympiques de 2016, ce chiffre est monté à 50% ».
Pourtant, lors de leurs premières compétitions, les boxeuses étaient mal accueillies sur les rings. « Lors des premiers combats de filles, elles se faisaient siffler, huer. Ce n’était pas mal vu de faire de la boxe, mais c’était un monde très macho », raconte Sandrine Moisan. Alors que les hommes sont présents sur les rings des Jeux Olympiques depuis 1904, la boxe féminine y a été admise 108 ans plus tard, en 2012. Même constat en France, où la première compétition de boxe féminine a eu lieu en 1997. Les premiers championnats du monde amateurs n’ont eu lieu que quatre ans plus tard aux Etats-Unis. Un début tardif que Loïc Le Meitour explique par la peur de voir des femmes boxer : « Ceux qui étaient à la tête de la boxe anglaise ne voyaient pas d’un très bon œil la féminisation de la boxe. Pour eux, c’était un sport pour les hommes, car c’est dur physiquement ». L’arrivée des femmes dans les compétitions ces vingt dernières années coïncide avec l’augmentation du nombre de licenciées. Ce phénomène peut également s’expliquer, en partie, par la hausse du nombre d’agressions dans la rue.
86% des femmes agressées dans la rue
« Savoir que tu connais des techniques, c’est rassurant. Mais s’il a un couteau, on ne peut rien faire », admet Mona Cazin, étudiante. L’insécurité est l’une des raisons les plus courantes évoquées par les femmes lorsqu’elles se lancent dans la pratique d’un sport de combat. Solenn Le Mée, 18 ans, a commencé la boxe américaine dans le but d’apprendre « les bases pour se défendre. Plus le temps passe et plus je me rends compte que les agressions n'arrivent pas qu'aux autres ». Selon une étude de la fondation Jean Jaurès publiée en 2018, 86% des femmes déclarent avoir déjà subi une forme d’agression dans la rue. Quant aux violences sexuelles, elles ont augmenté de 12% en 2019, d’après le ministère de l’Intérieur. Face à ce constat, des alternatives aux sports de combat se sont développées. « Celles qui veulent surtout apprendre à se défendre iront vers de la self défense », précise Mona Cazin. À Rennes, le club Défenses Tactiques propose des enseignements de self défense réservés aux femmes. L’entraîneur Frédéric Faudemer a créé ce cours lorsqu’il s’est aperçu que beaucoup de femmes s’étaient déjà fait agresser. Pour le coach, les demandes d’adhésion se multiplient. « On en a 87 actuellement et, en moyenne, on compte de dix à quinze inscriptions en plus chaque année, tout âge confondu ».
Parmi les femmes inscrites aux cours de Défenses Tactiques, « environ 80% ont subi une forme de harcèlement » conclut Frédéric Faudemer. C’est ce qui a poussé Lucie Roussel, réceptionniste de 23 ans, à commencer la pratique d’un sport de combat. « J’étais harcelée au lycée. J’ai commencé le karaté pour apprendre à me défendre ». Même chose pour Victorine Crusson, ancienne adhérente dans le club Défenses Tactiques : « On apprenait à observer, à repérer la personne qui pourrait nous agresser, à relever comment elle était habillée pour pouvoir faire une déposition ». Grâce à ces cours, Marie Coyac appréhende plus sereinement ses trajets. « Je voulais apprendre des techniques pour me défendre, pour être un peu plus tranquille dans la rue ».
Un moyen de s’émanciper
Cette confiance dans la rue va de pair avec une meilleure confiance en soi. Les femmes voient les sports de combat comme un moyen de sortir des codes, en pratiquant des disciplines jusque-là majoritairement masculines. À 20 ans, Julie Voyard souhaitait se démarquer : « J'ai commencé à faire de la boxe en 2012 car j'ai toujours aimé les sports de combat et je me sentais forte en boxant. Je voulais aussi faire mes preuves dans ce milieu essentiellement masculin ». C’est également le cas de Marie Leroy, 20 ans, qui a renforcé sa confiance en elle grâce à la boxe. « Pendant la période du collège, je n’étais pas bien dans ma peau. Ça m’a permis de m’affirmer. Tu ne peux pas vraiment être timide quand tu fais de la boxe ». « Je suis la plupart des judokates françaises sur les réseaux sociaux et je regarde leurs combats à la télé. La seule médaillée olympique française est Clarisse Agbegnenou », nous confie la lycéenne Yanna Le Gland, qui pratique le judo depuis dix ans. La médiatisation des sportives de haut niveau devient de plus en plus fréquente et permet aux femmes de s’identifier. Ce changement a encouragé Lucie Roussel à pratiquer de l'aïkido et du karaté pendant plusieurs années. « Je lisais des magazines sur le karaté et j’avais des modèles féminins ».
Cette tendance se confirme aussi chez les boxeur·euse·s. Leurs effectifs ont augmenté après les Jeux Olympiques de 2004, 2008 et 2012 (+ 29,02 %, + 33,20 % ; 21,39 %). La boxe féminine n’est arrivée aux Jeux Olympiques qu’en 2012. Cette hausse est surtout visible après les J.O de 2016.
Maurine Atef a un palmarès impressionnant : onze fois championne de France toutes boxes confondues, une fois championne d'Europe et deux fois championne du monde en boxe française, une fois vice-championne du monde et une fois championne du monde en kick boxing. La championne de l’US Créteil, qui aime « par-dessus tout dépasser ses limites », voit quotidiennement les conséquences positives de la médiatisation de sportives de haut niveau.
« Les jeunes filles de mon club sont impressionnées par mon parcours, qui leur donne envie de faire pareil. Ça les fidélise et elles amènent leurs copines, ce qui augmente le nombre de féminines ».Avec 60 % de femmes dans son club, elle remarque une forte augmentation depuis ses débuts, quatorze ans plus tôt. « Les préjugés sexistes sur la boxe ont nettement diminué. Le fait de médiatiser certaines championnes, comme Estelle Mossely ou Sarah Ourahmoune a beaucoup aidé », affirme la boxeuse. La championne participe aussi à l’évolution des mentalités, qui passe par la démocratisation féminine des sports de combat.